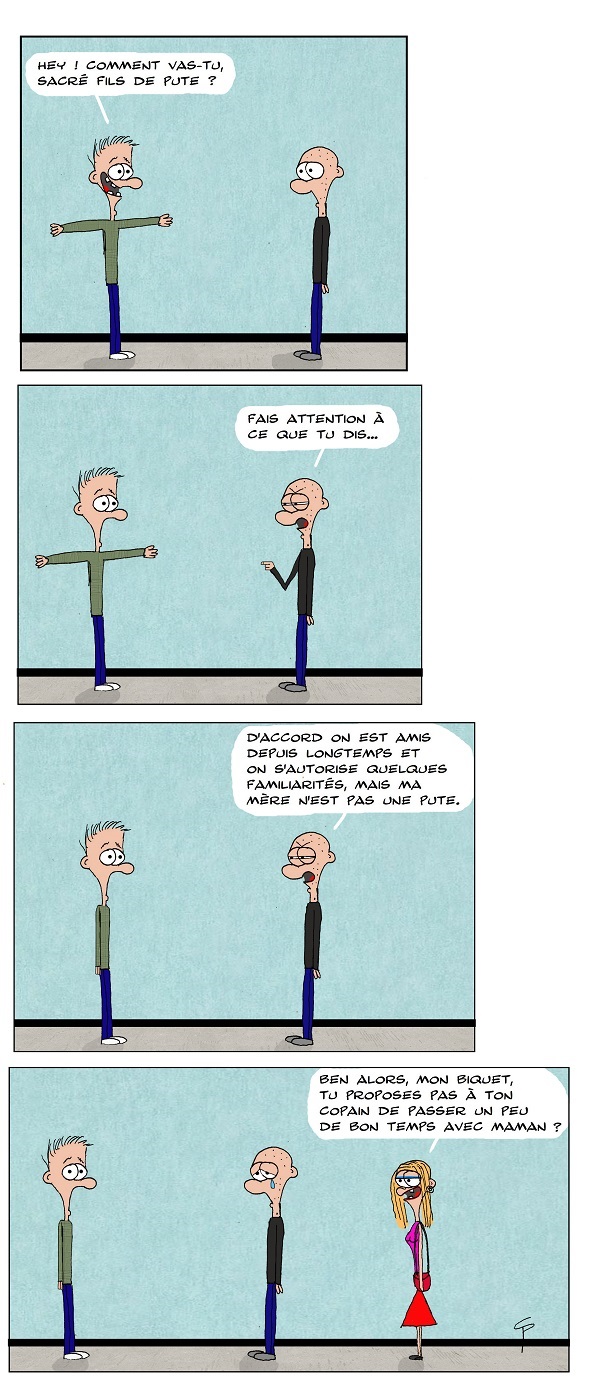-
Un conte moderne

Debout devant son miroir, Mattéo ne s’était sans doute jamais senti aussi stressé.
C’était son premier rencard, faut dire. Et à 21 ans, on a accumulé beaucoup de frustration à l’endroit du sexe faible. Papy avait beau lui dire que c’était facile, une femme, qu’il suffisait de lui promettre tout ce qu’elle voulait, et que même si elle n’y croyait pas, elle rentrerait quand même dans ce jeu d’illusions, parce que les femmes, ça reste pragmatique avant tout, et que promettre la vie d’un millionnaire pour finir par offrir celle d’un cadre moyen, c’est du domaine de l’acceptable, quand on est une femme pas trop naïve.Mais papy avait grandi dans les années 60, à une époque où aborder une femme dans la rue n’était pas considéré comme une agression sexuelle. À une époque où le moindre dérapage, la moindre blague graveleuse, ne risquait pas non plus de finir sur Internet, commenté et retweeté à l’infini par les oracles de la bonne morale, ligueurs de vertu des temps modernes. Papy, il aurait bien pu flanquer des mains aux fesses quand il avait l’âge de son petit-fils, que ça ne l’aurait pas conduit au violon. Il venait d’un autre temps, papy. Et ce temps jadis, aux yeux de Mattéo, c’était quelque chose comme l’ère Carbonifère.
Dans le grand lexique de la novlangue actuelle, on aurait facilement pu dire de Mattéo qu’il était un Incel. Vous savez, ces gamins qui n’ont pas de petites amies, finissent par se sentir humiliés par les filles au point de leur vouer une haine farouche, et préfèrent, au fond, se palucher devant du porno violent, histoire d’expurger leur rancœur. On aurait pu le dire, oui. Mais on se serait trompé. Mattéo était un gosse paumé dans un corps d’adulte. Résolument hétérosexuel à une époque où l’être était considéré comme réactionnaire, il était partagé entre sa peur des femmes et son attirance pour elles. Comme beaucoup de gamins de son âge, vous me direz… Mais sans doute était-ce un peu plus le cas pour lui, pour être honnête, au vu du nombre d’obstacles majorés qu’il était amené à devoir affronter.
Bourré de complexes, sans la moindre confiance en lui, il lui en avait fallu, du courage, pour finir par inviter Sylvie. Il avait rejoué la scène des centaines de fois dans sa tête. Il se voyait aller acheter son petit pain au raisin quotidien, oser lui tendre ce petit mot qu’il avait mis des jours à écrire, puis s’en aller, espérant une réponse par SMS de cette apprentie pâtissière de son cœur. Sur le petit mot, il avait écrit un poème, puis inscrit son numéro. Un vrai poème, écrit par lui, personnellement, sans aucune aide de ChatGPT, Grok ou Claude, de la poésie analogique issue d’une intelligence relative, mais authentiquement organique : la sienne. Il était question d’amour, de fleurs, d’avenir, de passion, c’était un collier de niaiseries enfilées les unes sur les autres, mais des niaiseries d’une sincérité indéniable. Et c’était ça qui pouvait faire la différence.
Le moment où il avait reçu le fameux SMS, la réponse tant attendue, avait probablement été l’instant le plus intense de toute sa vie. « sété tré joli » avait commenté la pâtissière. Et elle avait ajouté cet émoticône du petit bonhomme qui envoie un baiser avec un cœur. Dans le langage numérique, on n’envoyait jamais un tel émoticône sans raison. Il était lourd de sens, celui-là. Un émoticône qui envoie un clin d’œil, et ç’aurait été la douche froide, un simple signe de sympathie avec une fin de non-recevoir, le « cordialement » des relations hommes-femmes. À peine moins humiliant qu’un ghosting. Mais là… C’était tout un champ des possibles qui s’ouvrait à Mattéo. Son papy aurait été fier !
Il y avait ensuite eu tous ces échanges. Elle était fan de Jul. Lui ne pouvait pas le sacquer, mais il devint son plus grand admirateur pour satisfaire sa dulcinée. Il aimait plutôt la musique d’Ariana Grande, mais comme Sylvie la trouvait « tro prétenssieuse », il se rangea à son opinion. L’amour vaut bien quelques compromissions. C’était touchant de les voir communiquer ainsi depuis leur candeur respective. Lui, dont le manque d’estime de soi avait ravagé de névroses tout sens du courage, toute témérité ; et elle, encore vierge de toute influence féministe, voyant les hommes comme des individus étranges, parfois attirants, et dont elle sentait bien qu’elle était dépendante de leur attention.
Sylvie était un petit bout de femme de 18 ans, les cheveux toujours attachés en arrière, de petites lunettes rectangulaires trop grandes, fichées sur son nez, et qu’elle ne cessait de remettre en place d’un mouvement de l’index qui avait fini par devenir un tic. Issue d’un milieu modeste, elle n’avait pas une grande culture littéraire, mais avait tout de même vu quelques Walt Disney. Elle connaissait l’image d’Épinal du prince charmant. Et il lui semblait que Mattéo était plutôt charmant, à défaut d’être un prince.
Après plusieurs semaines et bien des économies, Mattéo avait fini par lui proposer le grand jeu : un dîner au restaurant. Ce truc, c’était un indémodable. Dans tous les pays du monde et à toutes les époques, une femme qui se faisait inviter au resto se retrouvait dans ses petits souliers. Il avait bien pris soin de lui demander si elle était végétarienne (elle ne l’était pas) ou si elle avait des préférences particulières en termes culinaires (elle n’en avait pas non plus) et avait choisi de l’emmener Chez Yvonne, au centre-ville de Strasbourg. Par snobisme, uniquement. Mattéo n’avait jamais été au restaurant de sa vie, si on excepte quelques passages à McDo et un au Buffalo Grill, avec papy. Chez Yvonne, c’était cet endroit qui brillait par la qualité de sa clientèle, composée de politiques, d’acteurs et d’autres membres du showbiz. C’est qu’il avait envie de l’impressionner, sa belle.
Un jeune couple d’Alsaciens qui part dîner au restaurant, quoi de plus banal pour l’observateur, mais Mattéo avait l’impression d’y jouer sa vie. Il l’avait vue arriver de loin, place Kléber, avec une robe rouge qu’elle avait dû emprunter et qui la boudinait un peu. Elle avait lâché ses cheveux, lesquels lui retombaient parfois sur le visage, alors elle les remettait en place d’un geste de la main qui foudroyait de tendresse son soupirant.
On avait parlé musique, boulot, on s’était un peu raconté sa vie, son passé, on avait évoqué ses origines sociales (classe moyenne inférieure pour Mattéo, prolétariat pour Sylvie) et puis il avait sorti sa carte bleue et avait réglé l’addition. Sylvie s’était sentie, pour la première fois de sa vie, comme une princesse.
C’était la nuit lorsqu’ils sortirent du restaurant. Sylvie tenait Mattéo par le bras. Elle s’appuyait contre son épaule, et cela donnait une sorte de démarche mutuelle maladroite, comme un couple de manchots désynchronisés peinant à s’accorder sur le rythme à suivre. Mais c’était toute l’allégorie de la jeunesse amoureuse : des rapports maladroits mais sincères, des sentiments forts mais si durs à exprimer. Et arriva le moment du baiser.
Il s’était entraîné des centaines, des milliers de fois, Mattéo. Sur sa main, sur le miroir, même sur le poster d’Ariana Grande qui trônait dans sa chambre, au-dessus de son lit (et qu’il devrait penser à retirer avant que Sylvie ne tombe dessus)… Il s’était avancé, les lèvres semi-ouvertes, alors que de son côté, Sylvie entamait une manœuvre identique, et c’était là que le drame était advenu.
Le caséum, c’est une sorte de substance pâteuse, malodorante, qui s’accumule au niveau des amygdales. On en a tous, statistiquement. Mais certaines personnes en fabriquent plus que d’autres. Celles qui, comme Mattéo, ont souffert d’angines à répétition dans l’enfance, par exemple. Ça vous creuse des amygdales bien profondes, et ça favorise l’apparition de cette saloperie.
C’est pile au moment où la langue de Mattéo commençait à s’enrouler autour de celle de Sylvie qu’un gros bloc de ce fromage fétide s’échappa des fosses amygdaliennes de notre prince charmant. Il termina sous la langue de sa dulcinée, puis contre ses molaires, pour finir par s’écraser sur son palais, exhalant toute la puanteur pestilentielle contenue dans la faune bactérienne de la chose.
L’effet fut immédiat, et à la hauteur du naturel populaire de Sylvie. « Haaaan mais tu pues d’la gueule, t’es un porc ! T’as dégueulé dans ma bouche ou quoi ?! » lança-t-elle sans mesurer la portée désastreuse d’une telle accusation. Puis, à peine une seconde se passa avant qu’elle ne se mette à vomir le repas qu’elle venait de prendre. Pas loin de cinquante euros de bouffe répandus sur les pavés strasbourgeois. Incrédule, Mattéo s’était avancé pour tenir les cheveux de sa belle afin qu’ils ne soient pas gorgés de vomi (il avait vu faire dans les films) et s’était pris une énorme gifle, suivie d’un « me touche pas, putain ! »
Puis elle s’était éloignée, s’arrêtant parfois pour régurgiter de petits jets de dégueulis, comme on sème des graines au printemps. Mattéo avait l’impression d’être passé, en un quart de seconde, du paradis à l’enfer. Il rentra chez lui plus riche de deux trous. Un dans le portefeuille, l’autre dans le cœur.
Elle l’avait bloqué, évidemment. Sur tous ses réseaux. Et lorsqu’il se risqua à lui rendre visite à la boulangerie où elle travaillait, les yeux gorgés de larmes, elle fit intervenir Mohamed, l’apprenti-boulanger qui faisait près de deux mètres. « Elle veut pas t’voir. Dégage. » ordonna-t-il. Et Mattéo obtempéra, anéanti.
La dépression s’empara de lui. Il lui fallut plusieurs mois d’hospitalisation en milieu psychiatrique et une véritable camisole chimique pour réussir à sortir un bout de nez de cette mélancolie pathologique qui l’écrasait de tout son poids.
Deux années passèrent. On ne peut pas dire qu’il avait oublié Sylvie, il pensait à elle quasiment tous les jours, mais il avait réussi à passer outre, à ne plus se détruire en ruminant cette sombre mésaventure. Et puis — on devait être un samedi — et alors qu’il scrollait sur TikTok, il était tombé sur cette vidéo d’une jeune femme qui racontait son expérience. « Le mec, en sortant du resto, il a voulu me galocher, mais il puait trop d’la gueule, frère, on aurait cru qu’il avait bouffé un rat mort ! » et, partant d’un ricanement de sorcière, Sylvie, devenue streameuse, avait pointé sa caméra sur la photo de profil du compte Instagram de Mattéo, le jetant ainsi en pâture à une horde de plusieurs milliers de suiveurs aussi cruels que décérébrés.
Mattéo vivait dans un studio, au huitième étage d’un immeuble qui en comptait dix. Il les descendit en trois secondes, à la vitesse de la gravité. Il s’écrasa sur le sol dans un étrange bruit sourd qui évoquait un mélange de concassage de viande et d’os. Un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui se trouvait à moins de trois mètres, faillit se le prendre sur la tête. Lorsqu’il comprit ce qu’il venait d’arriver, il sortit son smartphone, le braqua sur le cadavre de Mattéo, devenu bouillie de sang et de viande morte, et commenta : « Wesh, c’est une dinguerie, frérot ! »
-
Histoire d’un rencard
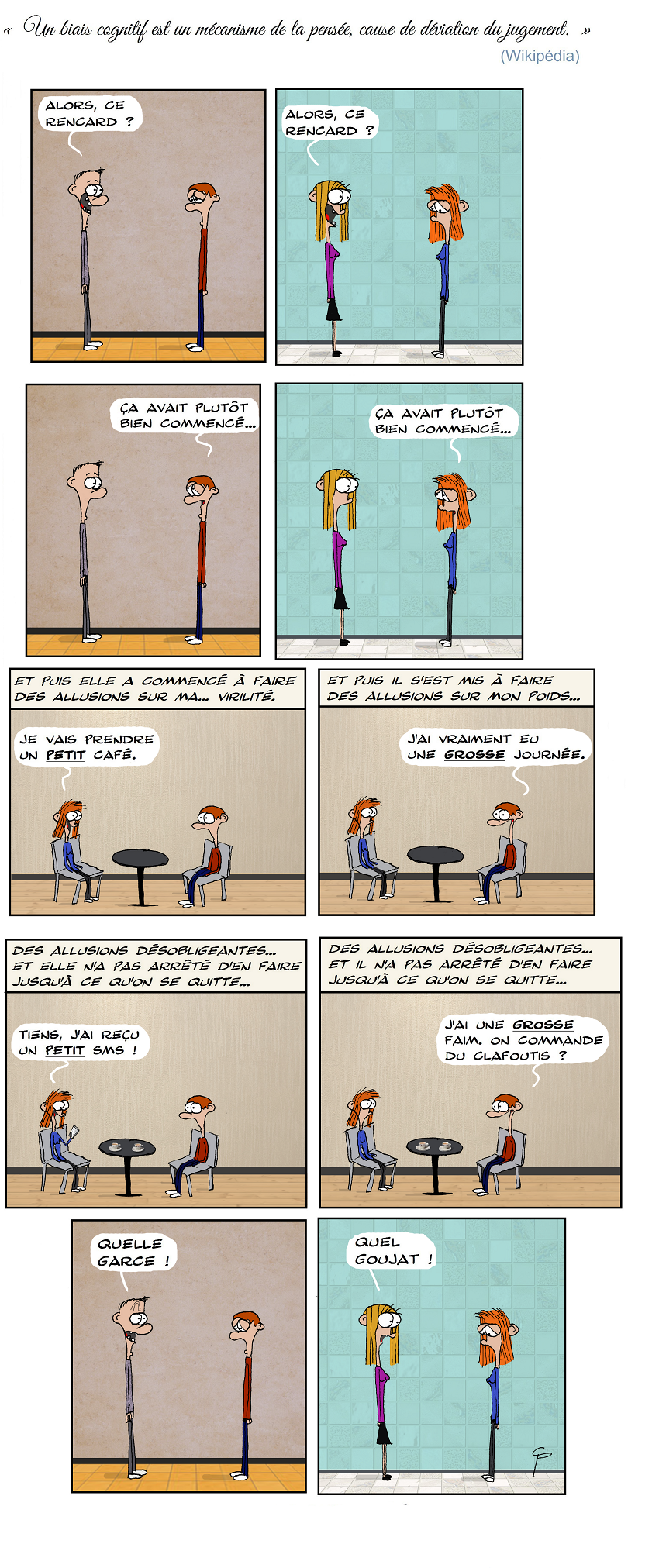
-
La capsule

« Ce foutu virus aura ma peau ! » éructait Jacques Moine entre deux quintes d’une toux sanglante. Pâle comme un linge, alité depuis plus de deux semaines, on l’aurait facilement pris pour un cadavre. Un cadavre dont le fiel qui gorgeait son âme nihiliste agissait sur lui comme une sorte de rempart contre la maladie. Moine allait crever, il le savait et s’en réjouissait, mais beaucoup plus lentement que les autres. Ceci dit, arrivé un certain âge, vaut mieux mourir. Ce qui reste de ce qu’on a été ne vaut pas la peine d’être vu. Un fossile, porté aux nues par toute une génération de lecteurs idiots qui n’avaient pas compris que l’ œuvre de sa jeunesse valait mille fois celle de ses vieux jours. Bien plus transgressive, plus piquante, et tellement plus intelligente. En vieillissant, Moine avait pourri. Il avait lâchement cédé aux sirènes du conformisme et s’était mis à écrire de la merde, comme son éditeur le voulait. Pile dans l’air du temps, des romans sandwichs desquels Ruquier pouvait dire, en faisant semblant de les avoir lus, « qu’on ne pouvait plus les lâcher une fois commencés ». Moine avait fait mai 68, il avait érigé des barricades au nom d’un interdit d’interdire foulé au pied par les descendants de son idéologie libertaire. Des héritiers devenus plus moralistes, plus puritains que les pires grenouilles de bénitiers des années 50 contre lesquelles Moine s’était battu.
Le soir, avant de se coucher, Moine avait pris l’habitude de cracher à la face de son reflet dans le miroir. « Pauvre merde » sifflait-il pour lui-même. Sur les quarante-trois livres qu’il avait écrit, seuls les trois premiers étaient à son sens des œuvres majeures. « Sédition », « La fin » et « L’usurier » avaient un sens, voulaient dire quelque chose, transmettaient un message, une morale, forçaient le lecteur à la réflexion. Et tout ce qu’il avait écrit après cela n’était que du vent.
Ce qui rongeait Jacques Moine, en plus de la maladie, c’était l’idée qu’il laisserait une postérité médiocre. Car s’il pouvait encaisser toutes les futilités médiatiques qui l’aidaient à remplir son compte en banque, il se rongeait l’âme à l’idée de laisser de lui l’image d’un écrivain plat et soumis. Alors il avait songé à la capsule temporelle.
L’idée était d’enterrer une capsule en métal hermétique à cinq mètres de profondeur. Laquelle serait remplie des œuvres non-publiées et totalement inconnues du public de Jacques Moine. Trois manuscrits qu’il avait écrits dans ce but précis, celui d’être découvert longtemps après sa mort afin qu’il soit célébré comme l’écrivain majeur du XXIè siècle. Un mythe, voilà ce qu’il voulait devenir.
Et puis il y avait eu le virus H5N1-dièse. La Grande Faucheuse, comme les médias l’avaient surnommé. Il avait généré une épidémie à côté de laquelle celle des années Covid passait pour une promenade de santé. Un virus contagieux, mortel dans 80 % des cas de contamination, issu d’une mutation du déjà très dangereux H5N1. Et Moine l’avait chopée, cette satanée maladie. Il était en phase 3. Toux, vomissements, maux de tête, fièvre. La phase 4, ça serait les convulsions, la perte de la raison, puis viendrait la phase 5, la phase terminale. Hémorragie cérébrale, liquéfaction des organes internes, décès.
Moine s’en foutait. Il était vieux et sa vie était derrière lui. Mourir d’une maladie de ce type ou d’un cancer, quand on a 90 ans, quelle différence ?
Au prix d’un effort harassant, et écrasé par plus de quarante degrés de fièvre, il s’extirpa de son lit, tout dégoulinant de sueur, et se traîna jusqu’à l’entrée de son manoir où il avait déposé, quelques jours plus tôt, sa capsule temporelle prête à être scellée .
Toute ma potentielle postérité réside dans ma capacité à ne pas mourir avant d’avoir enterré cette maudite capsule, songea l’écrivain, envahi par une angoisse dévorante. Il avait tout prévu. Dehors, l’attendait une pelleteuse qu’il avait louée le mois passé. Pas question pour lui de creuser à la pelle un trou de trois mètres de profondeur. Il aurait fait une crise cardiaque au bout de trois pelletées. Il avait apprit à conduire ce type d’engin au cours de sa jeunesse prolétaire, et c’est avec beaucoup de difficulté qu’il réussit à grimper à son sommet.
Moine avait choisit une magnifique petite clairière pour y enterrer son message aux générations futures. En plus des trois manuscrits, il laissait une lettre qui expliquait ses renoncements, sa lâcheté et sa démarche d’écrivain en quête de repenti. Il fallut moins d’une quinzaine de minutes pour qu’un trou suffisamment profond soit creusé. La capsule y fut déposée, et lorsque Moine se leva pour s’assurer depuis le poste de pilotage de son engin qu’il pouvait maintenant combler le trou, son cœur se serra. C’était la faucheuse qui venait clôturer son compte. Moine s’effondra sur le côté, chuta du haut de la pelleteuse et s’écrasa pile à l’emplacement où gisait, quelques mètres plus bas, sa précieuse missive temporelle. C’est à ce moment là que la pluie se mit à tomber.
Au bout de quelques heures d’une pluie battante, les monticules de terre déposés par la pelleteuse sur les côtés du trou finirent par s’affaisser puis s’effondrèrent complètement, recouvrant et la capsule et le cadavre de son propriétaire.
La pluie tomba trois jours et trois nuits durant, et lorsqu’enfin le soleil perça entre les nuages, il ne restait plus le moindre indice pouvant laisser penser qu’on avait un jour creusé par ici, à l’exception de la pelleteuse, laquelle fut rapatriée deux jours plus tard par un agent de la société de location, toussant et crachant du sang, et qui creva le lendemain du même mal qui avait emporté Moine.
Des siècles s’écoulèrent. L’humanité, annihilée à plus de quatre-vingt dix pour cent à cause de la pandémie se remit péniblement de cette catastrophe. Aux alentours de l’an 3000, la planète Terre comptait cent millions d’êtres humains, contre seulement quelques centaines de milliers d’âmes à l’issue de l’épidémie.
Noyle était de ceux-là. Le monde dans lequel il grandissait était un monde vivant, jeune, intrépide. La baisse drastique de la population avait engendré chez l’Homme une frénésie de vie, de savoir et de spiritualité qui avaient mis un terme à ce qu’avait été jadis la société de consommation. Il y avait les avantages de la science, de la technologie sans ses inconvénients. L’usage de l’électricité, bien qu’existant, restait rare. Ce qui avait été naguère la France était désormais un large territoire composé d’une myriades de petits bourgs connectés entre eux par le commerce des denrées cultivables. Les trains sillonnaient le pays et chaque village, même le plus petit, avait sa gare. L’automobile, vestige de la société autodestructrice du 21e siècle, n’avait plus sa place qu’au milieu d’un musée. Il faisait bon vivre dans ce monde peu peuplé, donc peu en clin aux guerres, et où chacun avait la possibilité de se nourrir grâce au fruit de son travail. L’écrasante majorité de l’humanité était paysanne. Le plus noble des métiers de l’époque. Mais pas Noyle.
Noyle était passionné de littérature. Celle du 19e et du 20e siècle. Évidement pas celle des années vides, comme il aimait à qualifier le début du 21e siècle et son néant littéraire, où l’entre-soi bourgeois ne produisait plus que des livres de qualité médiocre, issus du plus consternant des népotisme. Noyle enseignait l’histoire de la littérature à l’université, mais son violon d’Ingres, c’était une sorte d’archéologie bien particulière.
Cela faisait presque trente ans qu’il s’échinait à retrouver des écrits perdus, des joyaux d’une littérature antérieure à ce grand Chaos qui avait remis de l’ordre dans les crânes. Et il en était sûr, le vieux Jacques Moine avait dû planquer quelque part des écrits inédits des plus subversifs. Noyle connaissait tout de l’œuvre de Moine. « Sédition », « La fin » et « l’usurier » avaient bouleversé sa vie et sa vision du monde comme seuls les livres de génie savent le faire. Dans ce qu’il restait d’archives, il avait rassemblé un certain nombres d’indices, de déclarations énigmatiques de Jacques Moine qui le laissait penser que l’écrivain avait forcément dû laisser, planqué quelque part, un genre de message pour la postérité. Noyle savait où Moine avait vécu ses derniers jours et aujourd’hui, après presque dix ans passés à solliciter l’État, il venait d’obtenir la permission de fouiller ce qui avait été jadis la propriété de l’écrivain.
* * *
Noyle faisait face à une immense assemblée d’érudits. Debout devant son pupitre, il relisait son discours avec fébrilité. Il avait encore du mal à y croire. Il se revoyait, dix jours plus tôt, exhumant la capsule temporelle dans laquelle il avait découvert les oeuvres inédites de Moine. Il se souvenait de cette intense exaltation qu’il avait ressenti lorsqu’il avait compris qu’il venait enfin de mettre la main sur ce trésor tant convoité. Et aujourd’hui, face à un public d’érudits venu des quatre coins du globe pour entendre ce qu’il avait à dire, il tremblait.
Noyle était pourtant loin d’être anxieux de nature, et ces tremblements n’étaient pas le fruit de l’angoisse que tout un chacun peut ressentir au moment de s’exprimer en public. Ils étaient d’un autre ordre. En relisant ses notes, il suait à grosses gouttes. Il sentait sa transpiration perler le long de son dos et tremper sa chemise. Et il avait chaud, oh comme il avait chaud.
Dans ses veines se multipliait la Grande Faucheuse, virus endormi des siècles aux abords d’une carcasse d’écrivain à demi-fossilisée qui, mélangée à l’humidité de la terre, lui avait servi de glacière.
Noyle avait terminé son discours. Il avait envie d’écourter les mondanités pour aller prendre le lit. Mais avant cela, il consenti tout de même à aller serrer quelques mains.
-
L’appareil

J’avais trouvé l’appareil dans un vide-grenier au début du mois de septembre. Une jolie Retinette de chez Kodak, modèle 1954. Un bel appareil argentique comme on n’en fait plus. Mon goût pour le vintage, alimenté par mon tempérament nostalgique, m’avait convaincu de l’acheter.
Il y avait d’abord eu le chat. Je nourrissais un matou presque sauvage qui s’aventurait souvent du côté de mon jardin et j’avais décidé d’en faire mon premier modèle. L’animal avait pris la pose avec docilité et j’avais effectué ainsi mes trois premiers clichés, plutôt réussis.
Après cela, je n’avais plus jamais revu le félin rôder autour de la maison. Mais les animaux, surtout lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes, ont souvent la vie courte, et je ne m’étais pas davantage alarmé de cette disparition.
Quelques mois plus tard, j’avais entrepris de photographier une jolie tourterelle qui avait fait son nid au-dessus de ma véranda. Une réussite, encore une fois, malheureusement suivie d’une nouvelle disparition. J’avais trouvé, plusieurs jours après, au hasard d’une promenade, le cadavre à demi décomposé de l’oiseau gisant dans un fossé.
C’est après avoir réalisé une photo de mariage que j’ai compris. Les vingt-cinq personnes qui figuraient sur le cliché avaient toutes cassé leur pipe au lendemain de l’évènement. Et si je ne dispose d’aucune preuve me permettant de l’affirmer, j’ai l’intime conviction qu’ils ont tous rendu l’âme au même moment. À la seconde près.
L’appareil tuait donc qui se laissait immortaliser par sa pellicule. J’étais stupéfait par cette découverte et n’avais pu réprimer quelques sanglots en songeant à ce pauvre chat que j’avais condamné à mort. Mes victimes humaines, elles, me faisaient bien moins de peine. Le mariage de ploucs auquel j’avais assisté ne m’avait rien laissé entrevoir d’irremplaçable. Des ploucs qui se marient à d’autres ploucs pour donner des familles de ploucs qui à leur tour se reproduiront entre ploucs et produiront des générations de ploucs à l’infini. Pas de quoi verser une larme, sinon pour la tristesse d’une telle mécanique.
Après avoir pesé le pour et le contre, et bien réfléchi à ce qu’impliquait un tel pouvoir, j’avais pris le parti d’épurer autour de moi les fantômes de mon passé. Les persécuteurs du CM2, les voyous de ma cinquième, les racketteurs de ma seconde ; j’avais patiemment cherché puis trouvé ces sadiques de ma jeunesse afin de leur tirer le portrait. Un massacre.
Tout au long de ma vie et jusqu’à l’année dernière, j’ai méthodiquement assassiné tous ceux qui avaient un jour pu me taper sur le système. Les voisins médisants, les électeurs socialistes, les mamans prolos qui poussent leurs rejetons immondes dans des poussettes discount, les homosexuels qui pensent que la pratique de la sodomie est une opinion politique, les féministes, les lecteurs de Télérama et les auditeurs de France inter, petits prédicateurs de la vertu aux fesses sales. J’épurais dans la joie barbare que me conférait mon pouvoir magique.
Et puis il y a eu Jérôme. Ce salopard de Jérôme. Il y a dix ans, je l’avais surpris au lit avec ma femme. Ou devrais-je dire mon ex-femme, car la découverte de ces traîtres en train de jouer à la bête à deux dos avait inévitablement conduit au divorce. Je n’avais jamais pu oublier la trogne rigolarde de Jérôme lorsqu’il s’était aperçu de ma présence dans la chambre. Loin d’avoir honte, il s’était amusé de la situation, de ma colère, de ma détresse, de mon malheur. Le prendre en photo a été pour moi un grand moment de jouissance… Jusqu’à ce qu’à l’instant du développement, je découvre ma silhouette en arrière-plan, comme au travers d’un kaléidoscope.
Appelez ça la guigne, le mauvais sort ou le karma, mais j’avais appuyé sur le bouton de déclenchement alors que Jérôme passait devant la vitrine d’un miroitier. Vous avouerez que c’est une drôle manière de se suicider. -
Consolation par l’absurde

-
L’oubli

-
La voix de la raison

-
La Grande Ligne Plate

L’homme est fasciné par la performance. Je crois que c’est ce constat qui a motivé Jorgen Phil a penser sa « grand ligne plate». L’idée, c’était de donner la possibilité à l’homme d’acheter physiquement son salut par sa performance physique. Un peu à la manière du gladiateur qui gagne sa liberté à force de combats héroïques dans l’arène.
La Grand Ligne Plate était une piste en bitume de 6000km qui reliait Paris à New-York en ligne droite. Elle surplombait les terres mais surtout les océans à plus de 2 000 mètres d’altitude. C’était une sacrée prouesse, un genre de « tunnel sous la manche » privé que Jorgen Phil s’était payé avec ses propres deniers, à la différence que ça n’était pas un tunnel et qu’il surplombait l’atlantique. Parler d’argent ici serait indécent, mais à l’époque de son inauguration, question coût, on parlait de la moitié du PIB de la Chine. Je ne saurais dire si on avait exagéré.
Emprunter la Grande Ligne Plate était gratuit. Bon, presque gratuit. On payait tout de même l’ascension. Depuis Paris, porte de saint-Cloud, on lâchait huit euros au liftier chargé de conduire le wagon jusque dans les hauteurs. Une fois là-haut, on montait sur son vélo et c’était parti pour le grand voyage. Ah oui, je n’ai pas précisé : la Grande Ligne n’était accessible qu’aux cyclistes.
De Paris à New-York, il n y avait rien d’autres que de la route. Ni buvettes, ni aire de restauration, ni gîte, ni hôtel. Une fois en haut, on avait intérêt à avoir pris de quoi tenir avec soi.
Je sais que le nom de Jorgen Phil vous dit quelque chose. Je vous aide : « Les saucisses Jorgen, on les aime, on les aiimmeuuh, les saucisses Jorgen, font la fête dans vos assiettes ! »
Voilà. Je n’ai encore jamais rencontré quelqu’un qui n’ai pas mangé un jour une saucisse Jorgen. L’air de rien, la saucisse, ça paye, ça paye plutôt pas mal. À notre époque, où l’or vaut cent fois moins qu’un boyau de cochon, on peut dire que le père Jorgen avait bien su mener sa barque. Ce qu’il avait gagné avec ses abattoirs, il l’avait investit dans sa Grand Ligne Plate. Philanthrope, le bonhomme, que je me disais.
La plupart de ceux qui choisissent la Grand Ligne Plate sont des marginaux. Ils quittent l’Europe pour partir « à la conquête de l’Amérique » ainsi qu’ils l’ont vu dans les films. Cette idée de tout recommencer ailleurs est tenace chez les désespérés. Moi, désespéré, je ne l’étais pas. J’avais juste le goût du défi et de l’aventure. Mon vélo était un modèle Z33 de chez Layer industrie. Je l’avais payé plus de 30 000 euros puisés sur l’hypothèque de ma maison. Pneus increvables, selle masseuse, injection d’endorphine et de cortisol à gogo, je me voyais faire l’aller-retour six fois en danseuse et en redemander ! J’imaginais les crépitements des appareils photos des journalistes à mon arrivée à New-York city, et ces quelques mots d’anglais que je leur lancerais du haut de ma superbe : « Well, that was nothing, you know ; it’s just… well, I mean : I’m just french ! » et les voir rire à ces bons mots.
Je suis parti un vendredi. J’avais bien dormi la nuit passée. Très important le sommeil. J’avais avalé un repas longue portée, ceux qui vous rassasient pour six jours. Comme je vous le dis, je n’avais rien laissé au hasard.
Lorsque l’ascenseur a atteint le sommet, le point de départ de La Grande Ligne Plate, je me suis senti envahi d’un sentiment d’orgueil. Lorsque l’on voit le monde d’en haut, on a vite l’impression d’être Dieu.
La route faisait environ deux cents mètres de largeur. Ça peut paraître beaucoup pour qui a l’habitude de rouler sur Terre, mais lorsque vous êtes suspendu à deux kilomètres du sol, les dimensions vous paraissent toujours trop étroites.
Un huissier avait donné le top départ et nous nous étions mis en route.
La plupart de mes compagnons d’aventures roulaient sur des vélos non-entretenus. À peine dix kilomètres passèrent avant que ne surviennent les premiers accidents. Pneus crevés, chute, chaîne qui cassent. Les petits joueurs faisaient demi-tour direction l’ascenseur. Heureusement pour eux, ils n’étaient pas encore bien loin du point de départ.
La nuit, j’avais l’habitude de planter ma tente tout au bord de la route. Les pieds dans le vide, je contemplais les nuages en croquant dans ma ration. Personne n’osait venir me déranger, tous me croyaient fou, inconscient de m’installer si prêt du bord. J’étais pourtant bien plus prudents qu’eux.
J’ai vu les premières bagarres à partir du kilomètre 400. Des coureurs partis sans prendre suffisamment de provisions, sans tente, sans réfléchir. Au kilomètre 900, j’avais déjà assisté à plusieurs scène de lynchage suivi de cannibalisme. Je passais devant eux, frais comme une rose, pédalant calmement sur mon vélo de luxe et ils ne semblaient même pas me voir. Sans doute croyaient-ils que j’étais un membre du staff pour être aussi propre sur moi à ce stade de la compétition.
Mais des membres du staff, il n y en avait pas. L’anarchie régnait du début à la fin, du départ jusqu’à l’arrivée. La Grande Ligne n’était couverte par aucune juridiction. L’on pouvait y tuer sans être inquiété et les participants ne s’en privaient pas.
La nuit, je m’asseyais sur le rebord du monde, les pieds dans le vide, et je regardais les autres me prendre pour un fou. Pratique, ce rôle de désaxé. C’est un répulsif à emmerdeur naturel. J’adorais voir les nuages d’en haut, j’oubliais que j’étais entouré de cinglés prêts à s’entre-tuer et je me contentais de profiter du voyage.
À mi-chemin, je ne croisais plus que des zombies. Ravagés par la fatigue, entamés par la tremblotte que provoque le cannibalisme, ils ne roulaient plus droits et finissaient par tomber dans le vide, comme des mouches aspergées d’insecticide.
Sur la ligne d’arrivée, nous étions environ soixante, contre plus de mille au départ.
Je ne dirais pas que j’étais en forme, non, mais je n’étais pas anéanti. J’avais bien préparé mon voyage, bien dormi, bien mangé, le voyage avait été rude mais passionnant. Lorsque j’ai vu la route s’incliner et s’incliner encore vers le bas, tel un pont-levis désarticulé, j’ai eu le bon réflexe.
Le modèle Z33 est munie d’une option rétropédalage à l’hydrogène. Coûteuse, l’option, mais j’aime mettre toutes les chances de mon coté.
Alors que tous les autres participants tombaient dans le vide, s’écrasant dans les bennes de ce qui me semblait être un énorme bâtiment de nettoyage industriel, je remontais une pente à 50 degrés en pédalant doucement pour aider le moteur.
J’ai fait peut-être trente kilomètres à contresens avant qu’une navette estampillée Jorgen Phil ne se pose devant moi. Deux types en costume, l’air très gênés, sont venus à ma rencontre et m’ont proposé un apéritif. Après un aussi long voyage, j’avais plutôt envie d’une douche et d’un bon lit, mais j’ai tout de même accepté de bon cœur.
Entre deux coupes de Cristal, ils m’ont fait une proposition du type de celles qu’on peut difficilement refuser. D’abord parce qu’ à une époque où 90% de l’humanité vit sous le seuil de pauvreté, on ne refuse pas dix millions d’euros. Ensuite parce que j’ai vite compris qu’il n y avait pas d’alternative viable à cette offre qu’ils me faisaient.
Ce que j’avais vu ne me donnait pas le droit de regagner l’humanité tout frais en vélo, comme si de rien n’était.
Depuis deux mois maintenant, je fais la promotion des saucisses Jorgen Phil partout dans le monde. J’en suis l’ambassadeur international. En tant que « grand vainqueur de la Grande Ligne Plate », on me reçoit comme un chef d’Etat partout où je vais.
Aujourd’hui, je peux vous le dire, « les saucisses Jorgen font la fête dans vos assiettes » , mais quelques jours auparavant, elles faisaient du vélo.
-
Haine aveugle

-
Péripathétique